Le 6 février 1952, le roi George VI s’éteignait à Sandringham, à l'âge de 56 ans. À près de 7000 km de là, non loin de Nairobi au Kenya, sa fille aînée de 25 ans, la princesse qu'il surnommait Lilibet devenait la reine Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni. Dans deux numéros, dont un spécial, Match avait livré le récit fleuve de ces heures pathétiques pour Sa jeune Majesté, pour sa famille, pour ses sujets…
PublicitéVoici les deux grands reportages consacrés à la disparition du roi George VI et à l'avènement de la reine Elizabeth II, tels que publiés dans Paris Match en 1952.
La suite après cette publicitéDécouvrez Rétro Match, l'actualité à travers les archives de Match...
La suite après cette publicitéParis Match n°152, 16 février 1952
Le roi est mort
Le roi George VI est mort silencieusement. Il n’a pas eu de ces agonies qui tiennent pendant des semaines les peuples haletants. George VI s’est éteint la nuit, pendant son sommeil, dans le château de Sandringham qu’il aimait entre tous et où il était né. Il a montré dans la mort la même réserve dont il avait fait preuve dans la vie. Il y a, jusque dans le communiqué publié par le palais de Buckingham, une singulière simplicité : « Le roi George VI, après s’être couché hier soir en bonne santé comme d’habitude, a trépassé dans les premières heures de la journée, paisiblement, sans s’être éveillé. » Le roi avait cinquante six ans.
Il y avait cent trente six jours qu’il avait été opéré du poumon. L’embolie qui l’a emporté est sans rapport direct avec cette intervention. Il devait partir au printemps pour l’Afrique du Sud. Le lendemain de sa mort, du balcon du palais Saint-James, le roi d’armes de la Jarretière, flanqué de hérauts précédés de quatre trompettes, raidis dans des pourpoints en fil d’or, proclamera en français, selon la tradition : « Elizabeth la deuxième, par la grâce de Dieu, notre légale et juste souveraine. » Le proclamateur a ensuite crié de toute sa force : « Dieu sauve la reine ! »
La suite après cette publicitéLa suite après cette publicitéSon cri répété par le duc de Norfolk, connétable et premier pair du Royaume, a été repris ensuite par toute l’assistance. Il a touché au cœur la superstitieuse Angleterre. Elle y a vu le signe d’un de ces règnes qui, d’Elizabeth à Victoria, portent des noms de femmes.
Elizabeth était partie pour un nouveau voyage de noces...
Le destin n’a donné que trois jours de vacances à Elizabeth. Presque tout de suite il est venu la surprendre. Au petit matin, dans une maison isolée dans la forêt africaine, elle a reçu au visage la phrase terrible : « Le roi est mort. » Elle a chancelé sous le double poids des voiles de deuil et de la lourde couronne. Le noir ne sied pas à Elizabeth. Elle a sangloté sans rien dire. Elle a vingt-six ans, la jeune mère et la jeune épouse en robe claire ! Ils étaient heureux depuis le dimanche précédent, quand elle était entrée avec Philip dans la petite maison de bois aux fenêtres blanches. La clé avait mal tourné dans la serrure ; il avait fallu forcer mais personne n'avait conclu pour cela que le sort fût hostile.
Au contraire. Les êtres et les choses étaient devenus des complices. On était en Afrique et l'on était en été. Dans l'air il y avait des ballets de mouches roses et autour de la maison des arbres qu'on aurait pris pour des pommiers s’ils n’avaient eu des feuilles vert bleu grandes comme des chapeaux de soleil. Ils étaient seuls dans ce domaine de parfums et de couleurs. Ou du moins autant que des princes peuvent l’être. Leur solitude avait quelques centaines de mètres de long. Elle était ce jardin embaumé ceinturé par de hautes palissades : derrière elles, il y avait la forêt, ses profondeurs obscures et ses bêtes sauvages. Il y avait aussi cent hommes armés qui veillaient nuit et jour et qui étaient à la fois leurs défenseurs et leurs geôliers.
« Royal Lodge », la chaumière royale, à 160 kilomètres de Nairobi, capitale du Kenya, n'était que la première étape d’un gigantesque voyage de noces de cinq mois et demi. Les époux volants s'étaient donné la moitié de la Terre comme promenade sentimentale : 48.270 kilomètres de l'Europe à l’Asie en traversant l'Afrique. De Londres à Londres, via Nairobi, Colombo, Melbourne, Sydney et la Nouvelle-Zélande. Leur jeunesse et leur bonheur les désignaient pour être les commis voyageurs de la couronne. Avec leurs sourires, leurs joues roses et leurs mains unies, ils venaient rappeler au Commonwealth que l'Angleterre se porte bien et que son avenir est assuré. L’Angleterre ne les quittait pas des yeux. Chacun des gestes de Philip, chacune des robes d'Elizabeth la passionnaient. Trois reporters de la BBC, en liaison avec les radios australienne et néo-zélandaise, racontaient heure par heure aux auditeurs anglais, comment leur princesse servait la cause de l’Empire en prenant des vacances. C’était une lune de miel nationale.
Elizabeth se rappelait dans l’avion qui la ramenait vers Londres son départ de l’aérodrome, le jeudi 31 janvier. Toute la famille royale était là pour lui dire au revoir. Le roi était monté à bord. Il était resté dix minutes. Puis les moteurs s'étaient mis à vrombir ; il était descendu. Quand l’avion avait démarré pour prendre la piste, George VI avait levé la main tandis que la reine envoyait un baiser. La frêle silhouette de son père, le bras dressé, la pâleur de son visage et ses cheveux en désordre dans le vent des hélices, ce fut la dernière image qu’Elizabeth emporta de lui. Puis la famille royale avait grimpé sur une terrasse pour voir plus longtemps l’avion jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’un point noir dans la brume. M. Churchill resté au rez-de-chaussée observait le décollage, le nez collé à la vitre comme un écolier en pénitence.
Elle savait bien, Elizabeth, que ce voyage, c’était le roi qui devait l’accomplir ! Mais il n’en avait pas eu la force. Car c’est une entreprise exténuante de traverser un empire où le soleil ne se couche pas. Depuis la terrible opération de septembre 1951, George VI était moins un convalescent qu’un mourant en sursis. Il ne sortait pas sans une veste et des chaussures réchauffées grâce à une pile électrique. Sa voix avait été altérée par la maladie. En effet, en procédant à l’ablation totale de son poumon gauche, le chirurgien, sir Thomas Price, s’était vu contraint de sectionner un nerf pulmonaire influençant les cordes vocales au risque de le voir perdre totalement et définitivement la parole. Les sept médecins présents avaient pris alors cette responsabilité en signant une déclaration commune. Ils avaient été quelque peu soulagés en entendant le roi leur dire en ouvrant les yeux vingt-quatre heures après l’opération : « Good morning, gentlemen. » Pourtant, quand le souverain enregistra, pour Noël, son premier discours, les Anglais avaient remarqué que George VI parlait sur un ton rauque, comme son père, George V. Chaque jour, il faisait des exercices pour rendre de la souplesse à ses cordes vocales.
En montant dans l’avion, Elizabeth n'imaginait pas alors que le chemin parcouru en riant et en bavardant, elle allait, six jours plus tard, le refaire les larmes aux yeux.
Ce départ avait été heureux. Elizabeth avait pris la soupe à la tortue à 6.000 mètres au-dessus de Paris, le steak grillé en survolant Dijon et le cate en traversant les Alpes.
Après un arrêt d’une heure en Libye, l’avion volant de nuit était arrivé sans histoire à Nairobi le vendredi 1° février. Quatre cents chefs des tribus Turkana et Suk, en costumes d’indigènes coiffés de plumes d’autruche, drapés dans des peaux de léopard, l’attendaient rangés en file indienne. Ils trépignaient sur place, faisant cliqueter les anneaux de cuivre et d’argent qu’ils portaient aux poignets et aux chevilles. Elizabeth riait dans la lumière. Elle n’avait pas souffert de ces 30 degrés de chaleur et de ce soleil implacable presque à la verticale. A un mètre, Philip, en uniforme de gala de la marine, étoilé de l’ordre de la Jarretière, était son ombre.
Elle avait joué sans peine son rôle de souveraine. Elle a grandi dans les cérémonies officielles, au son des hymnes et des coups de canon. Un quart d’heure après avoir mis le pied sur le sol africain, elle visitait une maternité. Un petit garçon l’y attendait qui s’appelait « Prince » parce qu’il était né le même jour que le prince Charles. Il avait la peau noire et des yeux blancs qui roulaient de terreur. Il était si apeuré qu’il tourna le dos en voyant Elizabeth. Il avait fallu qu'elle lui prenne le bouquet des mains et le fasse pirouetter sur lui-même. Elle souriait toujours, mais sans cet air un peu égaré que doivent prendre les souverains pour avoir l’air de s’adresser à tout le monde. Cet enfant noir aux pieds nus était comme le négatif d’un enfant tout blond qui jouait à cette heure-là dans un palais de Londres en regardant la pluie couler sur les hautes fenêtres de son palais. Elizabeth se rappelait la dernière image de son fils à travers la vitre arrière de la voiture quittant Clarence House : un petit garçon sérieux, tout droit et tout triste sur le trottoir dans son manteau bleu pâle et qui agitait machinalement un drapeau australien en criant : « Good bye Mammy. » Elle croyait alors le quitter pour six mois. C’était pour six jours.
Le voyage était devenu agréable, le samedi matin, quand le couple princier avait passé la porte de chaume du Parc National de Nairobi, réserve de la faune africaine. Pour affronter les lions, les gazelles, les autruches, les girafes, les zèbres gambadant en liberté, la princesse s’était armée d’une caméra et de films couleur. Ce fut une véritable promenade dans un film de Walt Disney. Elizabeth eut le bonheur de se trouver soudain à 10 mètres d’une lionne entourée de ses quatre lionceaux. Elle fut enchantée : « Ils ressemblent, dit-elle, à une rangée d’ours dans un magasin de jouets. » En revenant, la princesse avait été acclamée par trente forçats en costumes rayés autorisés par exception à rester sur la route. Puis, le dimanche 3 février, ils étaient partis pour Nyeri, dans la maison que leur avait offerte le gouvernement du Kenya. Ils avaient fait trois heures de trajet dans une voiture « imperméable à la poussière ». Ils en étaient couverts en arrivant. « C’est incroyable, avait lancé Elizabeth que le plaisir rendait chaque jour plus bavarde, de penser qu’il y a dix-huit mois il n’y avait que la forêt »
Les jours suivants s’étaient envolés à une vitesse folle. Le lundi, Philip et Elizabeth s’étaient levés à l’aube? C’est le moment le plus calme de la journée. Ils avaient vu ensemble surgir le soleil derrière le mont Kenya, dans une apothéose de rose et de violet. Pour eux, ce lundi était le premier jour d’un week-end où ils n’allaient plus avoir de discours à faire, sinon l’un à l’autre, ni d'autres mains à serrer que les leurs. A 6 heures du matin, ils étaient partis à cheval et ne rentrèrent que pour le breakfast.
Au moment où ils prenaient le thé sur la terrasse, on les informa qu’on signalait la présence d’un troupeau d’éléphants. Ils bondirent dans leur voiture. Après avoir parcouru une dizaine de kilomètres, ils aperçurent, à 50 mètres de distance environ, un troupeau de trente éléphants roses.
Les éléphants roses sont en réalité des éléphants semblables à ceux que l’on peut voir dans toutes les jungles du monde, mais le sol du Kenya est tellement rouge, qu’il finit en quelque sorte par déteindre sur les éléphants ; ceux-ci aiment à aspirer la poussière rouge dans leur trompe et s’en aspergent le dos, ce qui leur donne cette couleur rose très spéciale.
La princesse avait mis en joue les éléphants avec sa caméra et pris de nouvelles images destinées à rejoindre, dans l’album de souvenirs, c’est-à-dire la cinémathèque de Clarence House, celles prises l’avant-veille avec les lions. Pendant la prise de vues, des gardes armés étaient prêts à intervenir.
La veille de la mort du roi George VI, Elizabeth et Philip avaient décidé de passer la journée et la nuit dans la forêt vierge. Elle avait mis un pantalon marron et un blouson militaire kaki. Elle était tête nue. Ils firent 15 kilomètres en voiture, puis s’engagèrent à pied dans un sentier. Ils étaient précédés par un garde armé d’un fusil au cas où un rhinocéros ou un éléphant aurait manifesté de la mauvaise humeur. La princesse avait été prévenue qu’au son d’une trompe d’alarme, elle devait immédiatement grimper à l’une des échelles de corde qui, tous les 30 mètres, avaient été accrochées aux arbres comme autant de balises de sauvetage. Elle était suivie de porteurs armés de couteaux et de lances et transportant des caisses de ravitaillement pour la nuit. Des centaines de soldats ascaris avaient été postés aux alentours, pour éloigner les curieux qui auraient pu importuner les hôtes.
Ils s’étaient donné pour objectif un observatoire perché au sommet d'un arbre. Cet observatoire est en réalité un véritable bungalow. On peut y vivre. Il comporte plusieurs pièces dont une chambre et une véranda. Il est situé à 12 mètres du sol dominant un point d’eau où viennent s’abreuver la nuit les bêtes sauvages : rhinocéros, éléphants, léopards, porcs sauvages, babouins, etc.
Les babouins étaient venus la veille, ils avaient pénétré dans la chambre royale et dévoré les abat-jour qui avaient été remplacés au dernier moment.
C’est dans ce lieu étrange, dans ce figuier géant qu’Elizabeth et Philip passèrent leur dernière nuit africaine. Ils veillèrent pour entrevoir les animaux sauvages. Ils crurent vivre un cauchemar, car avec l’obscurité commence un affreux concert. Les stridulations des insectes sont si puissantes qu’elles couvrent parfois la voix humaine. Sur ce fond crépitant éclatent, comme des solos de jazz, des appels étranges lancés du fond de la gorge par des bêtes lointaines et qui parlent d’amour, de peur et de faim.
Parfois quelque oiseau lance un rire malveillant. Quand la nuit est très claire, et que les éléphants roses rôdent dans les clairières, on entend leur barrissement semblable au hurlement strident d’une trompette. Le silence ne revient qu’avec l’aube. Quand Philip et Elizabeth s’assoupirent dans leur maison aérienne, à 6.000 kilomètres de là, le roi George VI, sur son lit doré du château de Sandringham, dormait son dernier sommeil. C’est dans un arbre, que la nouvelle reine d’Angleterre devait voir se lever le soleil sur son empire.
Il faisait encore nuit quand le télétype de l’East African Standard, le journal de Nairobi, passa un flash : « The King is dead. » Aussitôt l’état-major du journal se réunit et demanda confirmation à Londres. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonnait. La nouvelle était confirmée. Londres fut directement branché sur la « Royal Dodge ». L’officier d’ordonnance du prince Philip comprit tout de suite quelle nouvelle il avait à transmettre. Londres lui avait demandé d’avertir « Sa Majesté la reine Elizabeth ».
Celle-ci s’effondra dans les bras de son mari.
Pour la nouvelle reine et pour Philip le voyage est terminé. (Le paquebot Gothic, qui devait l’emmener à Colombo, a mis son pavillon en berne et baissé ses feux. Elizabeth II n’est plus, pour l’instant. qu’une enfant à genoux qui pleure un père disparu.
Mais l’Angleterre regarde avec fierté, à travers ses larmes, ce couple sacré qui lui revient du bout du monde. Jusqu’ici elle n’a voulu voir dans ces amoureux que Philémon et Baucis, et voilà qu'elle découvre — en filigrane de tant de jeunesse et de tant de majesté — les deux noms qui lui font toujours battre le cœur : Victoria et Albert. Déjà le God save the King est redevenu ce qu’il était il y a un siècle. Un mot a été changé. Depuis le 6 février, l'Angleterre demande à Dieu de « sauver la Reine ».
Paris Match n°153, 23 février 1952
Comment à travers ses larmes une princesse devient reine
Par Jean Farran
Le grand deuil de l'Angleterre. Pour Lilibet, George VI fut toujours “Papa chéri”.
Pendant une semaine, l'Angleterre n'a pas quitté des yeux Elizabeth. Elle l’a regardée comme on fixe ces funambules qui traversent les rivières sur une corde raide. Car pour une jeune femme de vingt-six ans, c'est un parcours terrible que celui qui conduit au trône, derrière le cercueil de son père. Mais Elizabeth n'a pas trébuché sous le poids du malheur. Elle n’a pas manqué ses premiers pas de reine.
L’Histoire avait prévu qu'elle les ferait à 16 h. 30, le jeudi 7 février, à l’aéroport de Londres. Le ciel était gris, une forte brise soufflait. Dans cette atmosphère de crépuscule, la seule note de couleur était donnée par les petites lumières bleues balisant la piste d’atterrissage. Il y avait peu de monde sur le terrain, les terrasses des bâtiments étaient désertes. M. Churchill avait demandé par radio aux Londoniens de ne pas venir à l’aérodrome. Il ignorait encore qui l'emporterait, chez Elizabeth, de la reine impassible ou de l’enfant éplorée. Un groupe d'hommes en noir, chapeau haut de forme sur la tète, attendait dans l’enceinte réservée aux personnalités officielles. Soudain l'avion surgit du plafond bas des nuages. A 16 h. 19 il atterrissait. Une escorte de motocyclistes l'entourait comme une nuée de mouches et le conduisait devant le building central de l’aérodrome. On poussa l’escalier roulant contre l’avion. Cependant, dix-sept personnes s’avançaient, conduites par le duc de Gloucester, frère du roi. La porte s’ouvrit. Le duc monta et gagna l'arrière où se trouvait le compartiment spécial de la reine. Les rideaux étaient fermés.
— Majesté ! dit-il tout de suite.
Et il embrassa la reine, puis lui remit un gros paquet de lettres personnelles. Sir Alan Lascelles, secrétaire personnel de George VI, était monté aussi saluer sa souveraine. Philip d’Edimbourg, un peu en arrière, observait, le visage immobile.
Puis les deux visiteurs redescendirent. Les hommes en noir s’étaient rangés devant l’escalier, comme pour une première revue. Ces vieux messieurs étaient tête nue et le vent faisait voler leurs cheveux gris. Le premier était M. Winston Churchill, un foulard de soie autour du cou. serrant sa canne dans sa main gauche. A côté de lui M. Clement Attlee, chef de l'opposition travailliste, appuyé sur son parapluie, puis M. Anthony Eden et M. Clement Davies, chef du parti libéral. Tous regardaient cette porte ouverte.
Soudain, après d’interminables secondes. Elizabeth II apparut et les lampes à magnésium des reporters éclatèrent. Elle était vêtue d’une robe et d’un manteau noir, elle avait un chapeau orné de plumes. Un seul bijou sur le parement de son manteau : un clip de diamants blancs, les seuls compatibles avec le deuil. Ce fut une surprise pour tous ceux qui vécurent cette minute historique. Elizabeth était partie de l’aérodrome d'Entebbe (Ouganda), en robe beige légère et c’est dans cette tenue qu'on s’attendait à la retrouver. Car si la princesse avait emporté deux robes, un manteau et deux chapeaux noirs, ils se trouvaient dans ses malles qui étaient à bord du yacht le Gothic, qui devait les emmener du port de Mombasa (Kenya ) à Pile de Ceylan. Un avion spécial alla les chercher et les transporta à l’aérodrome d’Entebbe. La reine se changea dans l'avion, aidée par miss Mac Donald, sa femme de chambre.
Elizabeth descendit lentement l'escalier. Elle était très pâle. Les témoins sont d’accord pour reconnaître qu'elle frissonna distinctement. Ses ministres s'étaient profondément inclinés. Elizabeth sourit tristement en tendant la main à M. Churchill. Le Premier était au bord des larmes. Il ne put dire d'une voix de gorge qu'une banale parole d'accueil. Elizabeth fit un sourire contraint à tous ses ministres. Sa première phrase fut pour Lord Woolton, Lord président du Conseil : « C'est un retour tragique, mais le vol fut extrêmement bon. » (« This is a very tragic homecoming, but the flight was extremely good.») Puis elle embrassa lady Mountbatten, sa tante par alliance. Philip, qui l’avait laissée descendre seule, l’avait rejointe. Au moment de monter dans la Daimler verte qui l’attendait, elle se retourna et fit un léger signe de tête à MM. Churchill et Attlee et aux ministres à leurs côtés.
Sur les 25 kilomètres qui séparent l’aérodrome de sa maison de Clarence House, les femmes étaient sur le pas de leurs portes, serrant au passage du cortège les enfants dans leurs jupes. Les hommes retiraient leur chapeau. Elizabeth faisait un signe de main. Elle redécouvrait l'Angleterre. Elle regardait cette fois avec d'autres yeux ces hommes et ces femmes dont elle était devenue la tutrice.
Au coin de Stable Yard Board; elle sourit : elle était arrivée chez elle.
Rien n’avait apparemment changé à Clarence House. Avec ses trois étages, son portique à colonnes et ses murs blancs, la vieille maison, construite sous George IV au début du XIXe siècle, avait toujours la même joyeuse apparence. Elle était une demeure d'amoureux. Il n’y avait que tapis d'Aubusson et meubles précieux. Au moment où Elizabeth y entra, l'étendard royal montait le long du mât, sur la terrasse. Il était 17 h. 5. Dans le grand salon, quelqu'un attendait la reine. Une très vieille dame en noir. Elle pleurait un fils, si Elizabeth pleurait un Père : c'était la reine Mary. Elle était d'une pâleur extrême.
« L'indomptable vieille dame », au regard sévère, debout en robe noire dans le grand et lumineux salon aux murs gris et ivoire, au plafond carré, était l’image même du désespoir. Pourtant, la mort ne lui était pas une inconnue. Elle avait vu mourir trois souverains : Victoria en 1901, Edouard VII en 1910, son mari George V en 1936: elle a perdu deux de ses fils, John en 1919 et le duc de Kent en 1942, officier dont le bombardier s’écrasa en Ecosse. Et voilà que « Bertie » à son tour... Mais elle est de ces femmes pour qui le malheur est un péché et la peine une maladie. Elle fut reine et elle se le rappelle. Elle s’est efforcée d'enseigner à Elizabeth, sa petite-fille, que chacun de ses gestes était de l'histoire. Elle ne pensait pas que pour le métier de souveraine il y eut de meilleur professeur qu'elle-même. La manière dont elle reçut, la veille, la nouvelle de la mort du roi, pourrait être un de ces exemples qu'elle entend donner en leçon. La reine Mary a pour règle de ne jamais répondre personnellement au téléphone.
« Ce n’est pas, dit-elle, affaire de reine. » Son secrétaire lui fait porter sur un plateau d'argent les communications qui lui sont destinées. Quand, le mercredi 6 février, à 10 h. 30, lé téléphone sonna dans la grande demeure de briques rouges de Marlborough House, elle resta immobile. Son secrétaire décrocha, resta silencieux, puis demanda : « Est-ce sûr ?» Il raccrocha, prit une feuille de papier où il écrivit seulement : « S. M. le roi est mort ce matin. » La reine Mary se leva sans dire un mot et passa dans sa chambre. Son visage était si bouleversé que sa fille, la princesse Mary, sœur du roi. fut aussitôt avertie. Pendant une heure, le bruit courut dans Londres que la vieille dame avait été emportée comme son fils par une embolie. Ce bruit avait été renforcé par la convocation inopinée de sir John Weir. médecin particulier du roi.
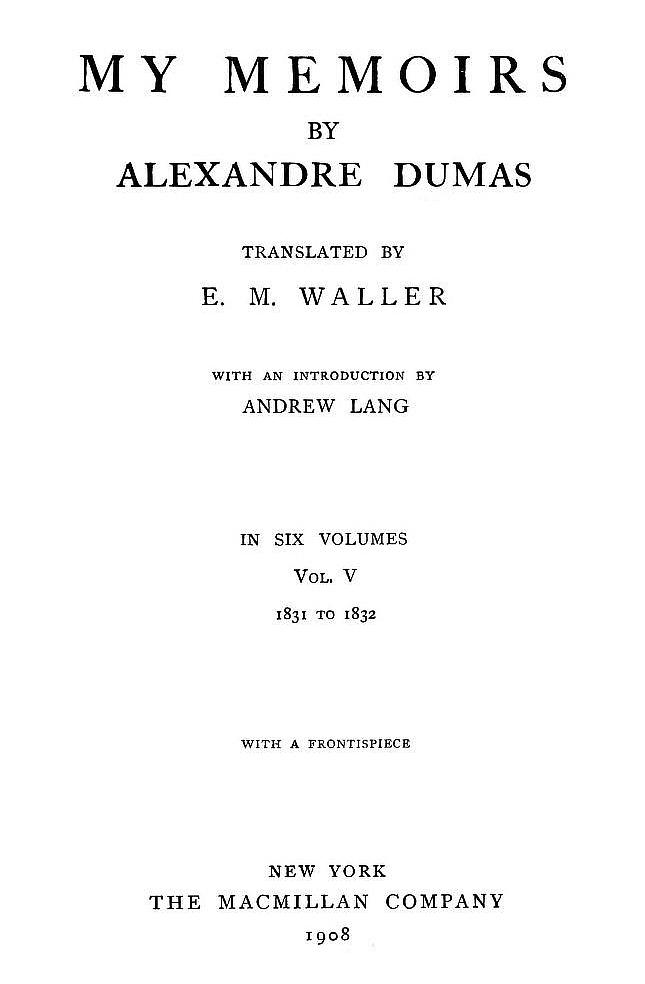
La princesse royale, arrivée en toute hâte, se rendit dans la chambre de sa mère. Elle s’était si pressée qu'elle avait une mèche de cheveux qui lui tombait sur la joue. « Quand vous entrez chez la reine, lui dit sa mère avant qu’elle ait pu parler, il conviendrait, s’il vous plaît, que vous fussiez bien coiffée. » La princesse se retira et ne revint qu’une demi-heure plus tard, au moment où sir John sortait souriant de la chambre, disant laconiquement : « Pas d’inquiétude à avoir. »
Elizabeth II et la reine Mary restèrent une demi-heure ensemble. Quand celle-ci partit, Elizabeth alla à la fenêtre, souleva le rideau et regarda longuement la cour où une grande Daimler démodée manoeuvrait pour sortir avec, à l’intérieur, se tenant droite sur la banquette, une vieille dame en noir devant qui les passants se découvraient.
La reine Elizabeth fit demander le secrétaire du roi, sir Alan Lascelles. Comme il entrait, elle appela Philip qui se trouvait dans la pièce voisine.
— Cette conversation a un caractère strictement privé, dit-elle, je ne pense pas qu’il y ait d’obstacles à ce que le duc y assiste.
Sir Alan lui apprit alors les conditions dans lesquelles était mort le roi.
« Sa Majesté, dit-il, avait chassé le lièvre mardi, de 9 heures du matin à 4 heures de l’après-midi, allant de place en place dans sa petite voiture de campagne. Il en avait tué neuf. Il avait donné rendez-vous à lord Sermoy. son voisin, et quelques amis pour recommencer le lendemain. Le maître d’hôtel du château avait reçu des ordres précis : « Soyez prêt à 7 heures. » Et le roi avait ajouté : « En hiver, c’est un bien beau spectacle que la campagne du Norfolk par une journée ensoleillée. » Le soir, avant de se coucher, il avait écouté au piano la princesse Margaret pendant une heure. Hier matin, le maître d’hôtel attendit dès 6 h. 30, à l’office, que sur le tableau le voyant s’allume, que tinte la petite sonnette de la chambre du roi. 7 heures, rien: 7 h. 30, toujours rien. 8 heures : Sa Majesté n'appelait toujours pas.
A 8 h. 30, le maître d'hôtel envoya aux nouvelles le valet de chambre du roi, Jimmy Mac Donald. Celui-ci frappa. Silence. Il recommença. Aucun bruit dans la pièce. Il ouvrit doucement la porte et s'avança jusqu’au lit. Il posa la tasse de thé qu'il tenait à la main sur la table de nuit et alla tirer les rideaux. Le roi ne cligna pas des yeux quand la lumière envahit la pièce. Il reposait les yeux clos, le visage détendu mais d'une blancheur anormale. Le maître d’hôtel, les femmes de chambre, la dame de compagnie de la reine furent alertés. Le château fut en rumeur. Enfin, la reine pénétra dans la chambre. Elle se pencha sur le lit. embrassa son mari sur le front, répétant deux fois d’une voix angoissée : « Il faut prévenir Elizabeth. » Puis elle fit sortir tout le monde et fit appeler la princesse Margaret : « Le roi votre Père est mort. »
M. Ansell, médecin local, arrivé en pyjama sous son pardessus, constata le décès. Ordre fut donné de garder encore secrète la mort du roi. Au château, avant que la nouvelle fût connue, on avait accroché sur une grille une pancarte portant seulement ces mots : « La chasse est décommandée.»
Elizabeth II écouta silencieusement, appuyée au bras de Philip. Toutes ces agonies royales, tous ces enterrements solennels qui pour le monde ne sont pas de l’histoire, pour Elizabeth étaient des drames de famille. Les récits qu’on lui en avait faits remontaient à sa mémoire : Victoria mourante dans son château néo-Renaissance de l'île de Wight battu par la mer et la tempête, s'éteignant un soir de janvier avec, à son chevet, la silhouette bonhomme du prince de Galles et celle plus rude de l’empereur d’Allemagne et murmurant, entre deux prières d'un évêque, son dernier mot. le nom de son fils. « Bertie ». Edouard VII faisant le matin de sa mort une scène à son valet de chambre qui ne lui avait pas donné le pantalon demandé, puis se couchant pour ne plus se relever, réagissant seulement quand on lui glissait dans l'oreille : « Witch of the air, votre jument, a gagné ». et murmurant une dernière phrase mystérieuse « Je ne céderai pas. » Le duc de Windsor avait longuement décrit à sa nièce la fin à Sandringham de George V, étrangement semblable à celle de George VI. « Vêtu d'une vieille robe de chambre tibétaine, relique fanée de ses visites aux Indes, raconte-t-il. il était assis dans son fauteuil favori devant un feu pétillant. Il semblait à moitié endormi. Bien qu’il ait entendu le peu de bruit que j’avais fait en entrant et qu'une lueur dans ses yeux « indiquât qu’il m’avait reconnu. Il ne paraissait pas entièrement conscient de ma présence. Par une large fenêtre il pouvait apercevoir, au-delà du jardin creux et des arbres dénudés, le clocher carré de l’église où flottait le pavillon royal. Dans un angle de la pièce se trouvait le simple lit de cuivre où mon grand-père avait dormi avant lui... Il mourut cinq minutes avant minuit. Ma mère eut soudain un geste inattendu. Elle prit ma main et la baisa. Avant que j’aie pu l'arrêter, mon frère George, qui se tenait près d'elle, s'avança et suivit son exemple»
Il y a cependant un secret dans les derniers mois de George VI. Celui de l'opération qu’il a subie en septembre. Il souffrait d'un cancer du poumon gauche. Trois théories s’opposent : Ce poumon lui a été enlevé complètement, partiellement et la dernière théorie : on ne le lui a pas enlevé du tout, car l’autre poumon aurait été atteint et toute ablation inutile. Aucune théorie n’a été officiellement approuvée.
Quoi qu'il en soit, le souverain était averti de la gravité de sa maladie. Il n’ignorait pas qu’il était condamné. «Le roi marchait avec la mort comme si elle était une compagne. Une compagne qu'il reconnaissait et qu’il ne craignait pas », a dit Churchill. George VI, à qui tout avait été interdit quand on avait l'espoir de le sauver, se permettait tout depuis qu’il se savait perdu. Il fumait, il sortait, il chassait. Malgré sa faiblesse physique, il avait tenu, à Noël, à s’adresser par radio au Commonwealth.
— La princesse Elizabeth pourrait parler à la place de Votre Majesté, lui avait-on suggéré.
— Elizabeth aura un jour l’occasion de prononcer elle-même ses propres adresses, répondit-il sèchement.
Il pressentait que ce discours serait un adieu.
En fin d'après-midi. Elizabeth s'occupa des formalités des funérailles avec le duc de Norfolk, grand maréchal de la Cour, le comte de Clarendon, lord Chambellan. Pour la première fois elle signa « Elizabeth Regina » un acte, celui autorisant l'exposition, à l’abbaye de Westminster du cercueil royal. Elle, d’habitude attentive et exigeante, ne changea rien à ce qui lui fut proposé. Elle écouta sans mot dire le long exposé des détails funèbres. Ce n’est qu'après qu’elle fit appeler Sandringham au téléphone. Elle s'entretint longuement avec sa mère, puis avec la princesse Margaret. Elle demanda le prince Charles dont certaines exclamations l’obligèrent à écarter légèrement l’écouteur de son oreille. Il connaissait le drame sans le comprendre. On lui avait dit que son grand-père était parti pour un long sommeil. Cela lui semblait un étrange voyage. Son grand-père lui avait promis de lui construire une maison et il ne l’avait pas construite, lui qui tenait tous ses engagements. Charlie s’étonnait de ce changement intervenu dans la maison. Les conversations à voix basse, les yeux rougis, les sourires crispés et tout ce monde en vêtements noirs. Il demanda à sa mère de venir le voir.
— Je serai là demain, promit-elle.
Elizabeth ne pouvait partir ce soir même. Elle devait se présenter devant le Conseil privé pour être proclamée reine et pour signer le parchemin qu'une cavalcade médiévale promènerait aux quatre coins de la capitale.
Vendredi, à 9 h. 40, vêtue d’un manteau d’astrakan et d’une toque de velours noir, elle passait la porte de Clarence House. Les grenadiers de la garde présentaient les armes, faisant sonner leurs baïonnettes. Elle se dirigea à pied vers Saint-James. Ce palais inhabité, qui fut construit par Henri VIII pour Anne Boleyn. est la plus ancienne résidence des rois d’Angleterre. Clarence House en est une sorte de dépendance, de date bien postérieure (1826). La reine marchait seule. Le duc d’Edimbourg la suivait à quelques mètres.
Quand elle entra dans la salle du Trône, les cent soixante-quinze membres du Conseil privé s’inclinèrent d’un même mouvement. « Le roi est mort, vive la reine ! » cria une voix officielle. Sur une table se trouvaient les parchemins. Elle les signa. Puis avec un marteau d’argent, elle fit le geste de défigurer l’empreinte de bronze qui n'avait plus cours. L'acte fut lu. La cire fondue pour un nouveau cachet. La reine prit la parole: « Vos Altesses Royales, mes Lords, Mesdames et Messieurs. J’ai le cœur trop gros pour parler longuement. Je demande à Dieu de m’aider à accomplir dignement la tâche qui m’a été confiée si tôt dans ma vie. »
C’était une singulière confrontation que cette jeune femme et son auditoire issu de la légende : évêques anglicans et presbytériens, représentants de la corporation de Londres en manteau écarlate brodé de fourrures et coiffés de bicornes, « Messieurs Justice » en perruques, ministres en haut de forme, conseillers du roi en tenue de cour et même deux conseillers de la reine Victoria âgés, l’un de quatre-vingt-dix-huit ans. l’autre de quatre-vingt-deux. C'était l’avenir qui se trouvait face à face avec le passé.
Elizabeth, sans assister à la proclamation publique qui allait se dérouler au balcon de Saint-James, regagna Clarence House. A vrai dire, elle allait pouvoir assister à ce spectacle extraordinaire sans quitter son fauteuil grâce au poste de télévision qui avait été spécialement installé. En compagnie de Philip, elle vit sur l’écran la proclamation en deux endroits : Saint-James et Charing Cross.
L’objectif de la télévision était braqué sur le balcon du palais tendu d’un drap sombre. Un silence presque religieux pesait sur la foule immense qui s’était massée et qui d’ailleurs, une demi-heure plus tôt, était si nerveuse qu’il avait fallu déployer un bataillon supplémentaire de grenadiers. Dans Londres, quatre-vingt-cinq lignes d'autobus avaient été détournées ou supprimées à cause des cérémonies. Soudain, Big Ben, l’horloge du Parlement, sonna 11 heures. Les sonneries de trompettes éclatèrent, tandis que la fenêtre s'ouvrit. Elizabeth vit le duc de Norfolk, comte maréchal du royaume, flanqué du roi d'armes de la Jarretière et des hérauts, la proclamer « reine de ce royaume et des autres royaumes et territoires qui lui appartiennent, chef du Commonwealth, défenseur de la foi ». C’était la première fois que cette formule était employée. George VI avait été proclamé « roi de Grande-Bretagne. d'Irlande et des dominions d'au-delà des mers, empereur des Indes, défenseur de la foi ». Il avait été le dernier souverain anglais à régner sur les Indes. La différence entre les deux petites phrases résumait le drame de l’Angleterre : l'effritement continu de son empire. La transmission dura cinquante minutes.
Après que l'orchestre eut joué God save the Queen et que la foule eût crié : « Vive la reine, longue vie à la reine ». se déroula un incident singulier.
— Jarretière, dit une voix mystérieuse, remettez donc votre chapeau.
Et l’on vit sir George Bellew, roi d'armes de l'ordre de la Jarretière, imperturbable dans sa magnifique robe brodée d’or du xv’ siècle, estimée à plus de 1 million de francs, se recoiffer lentement.
« La voix, dit bientôt le duc d'Edimbourg, qui avait demandé qu'on renseignât la reine était celle du duc de Norfolk qui, en aparté, conseillait à son voisin de ne pas rester seul tête nue quand tout le monde était coiffé. » Deux spectateurs assistèrent à la proclamation sans qu’on les remarquât : M. Churchill, d’une fenêtre du palais Saint-James, et la reine Mary, d'une fenêtre du troisième étage de Marlborough House.
Il était 13 h. 50 quand la Rolls vert foncé de la reine sortit de Clarence House. Les rideaux de la voiture étaient tirés. Mais bientôt, Elizabeth ordonna qu’on les ouvre. Quand la voiture fut sortie de Londres même, elle fit stopper. Le chauffeur et le détective qui était à son côté vinrent s’asseoir derrière. Le duc d'Edimbourg prit le volant et Elizabeth vint à sa droite. Il mit des lunettes noires et elle noua une écharpe autour de sa tête. Lorsqu'Elizabeth et Philip cessent d'être le centre de l’intérêt général, ils profitent de chaque occasion qui leur est donnée de sortir du personnage imposé. Quand l'avion qui la ramenait du Kenya en Angleterre survola les Alpes, la reine passa dans la cabine de pilotage où elle filma pendant un quart d'heure le mont Blanc et les chaines qui défilaient 1.000 mètres plus bas.
Aux approches de Sandringham, la voiture s’arrêta de nouveau. La reine et le duc d'Edimbourg reprirent leur place. Cent cinquante journalistes et photographes attendaient leur arrivée à l’entrée de Norwich où sont les grilles principales du domaine. Ils entrèrent par la petite grille du Jubilée. A l'est. Il y avait seulement quelques personnes. Il était 16 h. 32. Le duc avait mis 2 h. 42 pour couvrir 180 kilomètres. C'est une allure rapide, si l’on tient compte de la difficulté qu’il y a à sortir de l’interminable agglomération londonienne.
La Rolls suivit lentement la longue allée qui conduisait au château. Elle se rapprochait du malheur à chaque tour de roue. Elizabeth le sentait bien. Elle était dans la maison de son père. Les chênes, les ifs, les pins étaient comme des signes que faisait le passé. Sandringham était la demeure préférée de George VI. Il y venait quatre mois par an. sans compter les week-ends. On ne disait pas le château, mais la « grande maison ». En briques rouges, couverte d’ardoises, elle était gaie malgré les vents du nord qui balayaient cette plaine, patrie de Nelson. Son acte de naissance est gravé sur le fronton : « La maison a été construite par Albert Edward et Alexandra, sa femme, dans l’année de Notre Seigneur 1870. » Victoria n’y venait guère, si son fils y était souvent. Le passage le plus marquant qu'elle y fit fut pour voir Les Cloches, un mélodrame joué par soixante acteurs, avec un orchestre comptant autant de musiciens.
C'était plutôt une maison d'hommes. On y admirait Persimmon, avec qui Edouard Vil gagna le derby.
La mémoire d'Elizabeth était remplie du récit des fêtes qui s’y donnaient sous Edouard VII. Tous les 9 novembre, à l’anniversaire du roi, le château, sur la colline, renaissait à la vie dans un embrasement de lumière. Puis chaque jour, pendant une semaine, les champs résonnaient des salves du roi et des invités, qui décimaient les faisans élevés l’an passé. George VI était né à Sandringham, non pas au château, mais dans une maison appelée « la chaumière des célibataires », rebaptisée ensuite York Cottage, parce qu'Edouard VII l'avait donnée à son fils, alors duc d'York. Ces futurs rois George VI et Edouard VIII y avaient appris à lire et à compter. Ils levaient souvent la tête pour regarder l'étang à travers la vitre et, au-delà, le parc où ils cherchaient à distinguer les petits cerfs aux bois enchevêtrés qui erraient paisiblement. Dans le salon, la dame d’honneur se mettait au piano et les deux enfants royaux apprenaient Le vieux nègre Joe, O ma chère Clementine et Funiculi, Funicula. Le soir, ils se baignaient côte à côte dans des tubs en zinc.
Quand la voiture s’arrêta sous le porche couvert de lierre du château, Elizabeth connut une défaillance. Elle appréhendait cette rencontre avec sa mère. Elle craignait que la vue de son chagrin ne l’empêche de réfréner le sien. C'est ce qui se produisit lorsqu'elles se trouvèrent face à face. Pendant quelques secondes, elles restèrent maîtresses d’elles-mêmes, immobiles, les yeux dans les yeux. Puis quelque chose se déclencha en elles, qui fit tout craquer, et elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. La princesse Margaret s’était inclinée dès l'entrée de sa sœur et avait fait une profonde révérence. La reine mère reprit la première son sang-froid: se retournant, elle fit de la main un signe assez vague à l’adresse de quelques personnes qui étaient présentes, comme pour dire : «Voici votre nouvelle reine. ». Puis elle prit sa fille par le bras et la conduisit vers l’escalier. La reine mère, vêtue d’une robe noire, serrait dans sa main droite un fin mouchoir de dentelle blanche.
Le roi était mort dans une chambre du rez-de-chaussée, où le mauvais état de ses jambes l'obligeait à résider. Mais il avait été transporté au second étage, dans la chambre où George V était mort. Une lumière y brûlait en veilleuse. Sur le lit, le souverain, vêtu de l'uniforme d'amiral de la Hotte, avait la plus belle couverture : le drapeau. La reine mère se retira, laissant sa fille à genoux, en prières. Quand Elizabeth II redescendit, son mari, qui attendait au pied de l'escalier, lui prit le bras tendrement en voyant son visage bouleversé et la conduisit dans un salon voisin.
Une demi-heure plus tard, des pas pesants se firent entendre dans l'escalier. Quatre hommes descendaient, portant le cercueil sur leurs épaules. La dépouille royale avait été mise dans un triple cercueil de chêne, de plomb, de bois sculpté, où était fixée une plaque : « Albert-Frédéric-Arthur-George Windsor, né en 1895, mort en 1952. » Le cercueil fut posé sur un chariot monté sur roues, qui attendait à la porte.
Alors se forma le plus extraordinaire cortège peut-être de tous ceux qui suivirent le souverain jusqu'à Westminster. On était à cette heure qui n’est ni le jour ni la nuit et qu’on appelle entre chien et loup. Un croissant de lune se levait derrière le château. Devant le cercueil se trouvait un joueur de cornemuse, le major Alec Mac Donald, puis vingt fermiers du domaine portant chacun une torche. Derrière, huit gardes forestiers tiraient le chariot portant le cercueil recouvert de l'étendard royal. Elizabeth et sa mère — côte à côte — en grand deuil, la tête cachée sous de longs voiles noirs, suivaient à quelques mètres, précédant la princesse Margaret et le duc d'Edimbourg.
Le cortège, qu’on aurait cru ordonné par Shakespeare, s’engagea lentement entre les sapins, dans le sentier du roi. La cornemuse jouait Fleurs de la Forêt, la plus lamentable des complaintes écossaises. Un vent assez fort rabattait la flamme des torches. Dans l’étroit sentier, au passage du cercueil les branches mouillées laissaient sur le drapeau tomber de larges gouttes. Les notes aigres de la cornemuse répétant sans cesse le même motif, le silence des reines, les sanglots de Margaret, la nuit, les flambeaux, les cris répétés des chouettes dans l'ombre des sapins, le cercueil de ce roi, tout faisait de cette dernière promenade le moment le plus tragique peut-être qu'Elizabeth et les siens connurent au cours de cette si longue semaine. A un moment, le cortège s’arrêta. Le destin voulut que ce soit à un endroit découvert où le cercueil du roi marin se trouvait face à une ligne lointaine et argentée qu'on voyait scintiller sur l’horizon : la mer.
Un écran de toile avait été dressé dans les fougères, cachant complètement le sentier. Ce sont des ombres, que les curieux ont vu passer dans le parc solitaire.
La chapelle Sainte-Marie-Madeleine, où le corps fut déposé, est petite et médiévale. Sur son faite flottait le drapeau de Saint-Georges : pavillon blanc coupé en quatre par une croix muge, le seul drapeau qui ne fut pas en berne dans tout le Royaume-Uni. Sans regarder cette chapelle qu'elle connaissait tant.
Elizabeth tomba à genoux à côté de sa mère, de sa sœur et de son mari. Au bout de quelques instants, ceux-ci se levèrent, à la suite de la reine mère, et la laissèrent seule. Au bout de quelques minutes, Philip, qui était resté près de la porte, se rapprocha d’Elizabeth. Il posa sa main sur son bras, sans dire un mot. Elle leva la tête, le regarda hébétée, puis, comprenant, se leva à son tour.
Et la reine Elizabeth, appuyée au bras de son mari, refit le chemin jusqu’au château.
Elle se retira immédiatement dans sa chambre. C'est là que la nurse, miss Helen Lightboy, lui amena le prince Charles et la princesse Anne. La nurse avait appris au petit garçon à s’incliner, à baiser la main et à dire Votre Majesté. Il le fit, puis se jeta dans les bras de sa mère où il écouta les histoires de tigres et de gazelles que son père lui avait rapportées du Kenya.
Il est singulier de voir combien Philip a su se montrer à la fois précieux et discret avec sa femme. Souvent elle était seule, parce qu’elle était la reine, mais elle savait, sans avoir à se retourner, qu'il se tenait attentif, à quelques mètres d’elle ; Philip et Elizabeth forment un couple heureux. Aucune union n’est plus difficile que la leur. Car c’est une condition ingrate que celle de « mari de la reine ». Le duc d’Edimbourg semble suivre une politique de tact qui satisfait à la fois Elizabeth et l'Angleterre. Il a pour lui le meilleur atout : l'amour que lui porte sa femme. Pour lui, elle a pris le risque, par exemple, de le rejoindre à Malte quatre fois, de rester plusieurs semaines avec lui, privilège dont certaines femmes d'officiers lui tiennent encore rigueur. Elle a suivi des régimes et s’est fait maigrir ; elle a, sur les conseils de Margaret, transformé sa manière de s'habiller. Sans doute ne tenait-elle pas à justifier, même un jour lointain, la réponse de lord Melbourne à Victoria qui lui affirmait que son Albert ne regardait jamais aucune femme : « Non madame, ce genre de choses se passe plus tard, en général. » A vrai dire. Philip, que les milieux politiques anglais considèrent comme intelligent, a ouvert la fenêtre des salons renfermés où vivait Elizabeth, il lui a fait respirer un air nouveau. Il est le contraire des dandies de cour qu’elle rencontrait dans les « parties ». Il a eu une existence difficile. Il a même été pauvre.
C’est un titre qu'on ne rencontre pas couramment à Buckingham Palace. Son père, le prince André, commandant de l’aile droite de l’Armée grecque détruite en 1922 par Atatürk, se vit dépouillé de ses biens et banni de Grèce par une faction révolutionnaire. Un bateau de guerre anglais, la Calypso, l’emmena avec sa femme Alice vers l’exil. C'est-à-dire vers Paris. Philip était un bébé. Il était né à Corfou, l’année précédente.
La princesse Alice, sa mère, aujourd’hui rentrée dans un couvent, ouvrit sans succès rue du Faubourg-Saint-Honoré une boutique de broderies et d’œuvres artisanales grecques. Son beau-frère, le prince Nicolas, se fit peintre portraitiste. On mit Philip en pension. Il fit toutes les écoles de l'Europe. Saint-Cloud. Londres. Baden. l’Ecosse. Il entra en 1939 au royal collège naval de Dartmouth. Il servait à bord du cuirassé anglais Vailant comme officier chargé du contrôle des projecteurs lorsqu’il prit part en 1941 au fameux combat nocturne du cap Matapan où trois croiseurs italiens furent coulés en trois minutes. « C’était une action aussi proche du meurtre que cela peut l’être en temps de guerre », déclara-t-il plus tard.
Plusieurs fois dans son enfance il rencontra la princesse Elizabeth en robe courte et en chaussettes blanches, mais c’est pendant la guerre qu'ils refirent connaissance. Il fut plusieurs fois invité à Windsor, puis un mois à Balmoral, ce qui constituait aux yeux de la famille royale une épreuve. Il en sortit victorieux.
En décembre 1946, il sollicitait la naturalisation anglaise ; six mois plus tard les fiançailles étaient annoncées par une circulaire de la Cour. Le lendemain, à une garden party de Buckingham, pour la première fois Elizabeth apparaissait en public au bras de son fiancé.
Philip n’a pas la culture encyclopédique du prince Albert qui, en attendant Victoria, passait des heures à jouer à l’orgue les sonates de Mendelssohn, à travailler à des plans d'épandage pour l’agriculture, à étudier la lithographie, à dessiner des blasons. Il ne pense pas non plus, comme Oscar Wilde, que « si un homme est un gentleman il en sait toujours assez et que s’il n’est pas un gentleman tout ce qu’il sait peut être mauvais pour lui ». « Ma génération, dit-il. est probablement, à cause de la guerre, la moins cultivée de cette époque. » Et il le regrette.
Elizabeth aime cette sincérité. Elle lui est coutumière; il refuse de porter le masque convenu des princes tantôt éclatant de condescendance, tantôt figé par l'ennui. Un serviteur l’entendit un jour lancer à sa femme qui hésitait à l'accomnagner dans une promenade sous une petite pluie écossaise : « Bon. eh bien restez donc là, chère petite nigaude. »
L’Angleterre se félicite de trouver cette ombre grande et mince à côté de sa souveraine. Une couronne est devenue si lourde qu’il n’est pas trop d’être deux pour la porter. Sa Majesté Elizabeth II, en promenant son sceptre sur huit pays différents, s’oblige à travailler quatorze heures par jour, sept fois par semaine. Elle devra chaque année :
— Paraître cinq cents fois en public:
— Accorder mille audiences aux hommes d’Etat, diplomates et diverses personnalités étrangères;
— Accomplir un « tour » social complet pendant la saison :
— Voyager sur 100.000 kilomètres;
— Signer cent cinquante documents chaque jour.
Ce régime de travail forcé exige une santé de fer. Or, après son voyage au Canada Elizabeth était si épuisée que les médecins lui ordonnèrent trois semaines de repos sévère. Ce risque, le premier britannique et les ministres des principaux dominions ne veulent pas l’assumer. Il est relativement aisé de réserver sur les voyages officiels une partie de vacances ou de réduire le nombre de documents à parapher. Le point le plus délicat est de décharger la reine de trois cents cérémonies par an en l’y faisant représenter par la reine mère, le duc d’Edimbourg ou la princesse Margaret. Cette dernière prend la troisième place dans l’ordre de succession au trône, ce qui accroît son importance de personnage représentatif. C’est maintenant à Elizabeth de délimiter son activité ainsi que celle de la reine mère. Pour Philip, déjà conseiller privé depuis la maladie du roi, la reine peut apposer son grand sceau sur la lettre de patente qui lui donnerait rang royal. «Elle dépasserait ainsi son aïeule la reine Victoria qui, en faisant de son époux un prince consort, s'était adjointe : un secrétaire, un compagnon et une source de conseils pour sa femme. »
Une dernière question se pose dans les rapports de Philip et d’Elizabeth. Au moment de son mariage, le roi George VI tenait à ce qu’elle conservât le nom de Windsor. Mais Philip n’étant pas de cet avis, les choses en restèrent là. Aujourd’hui qu’elle est reine. Elizabeth se trouve devant l’alternative : être pour l’histoire une des souveraines de la maison de Windsor, ou la première reine de la maison de Mountbatten.
C'est à Londres lundi qu'Elizabeth a commencé de s’éloigner du cercueil du roi son père. Elle n’avait cessé depuis trois jours de l’accompagner. Mais cette fois l'heure était venue pour George VI de quitter sa famille et de passer une dernière fois son peuple en revue. Elizabeth quitta le train funèbre à la gare de King Cross et gagna directement Westminster. Quand elle entra suivie de la reine mère et de la princesse, deux gardes tombèrent évanouis. Elizabeth ne se détourna pas. Une reine n’a pas droit aux signes extérieurs de l'émotion.
Dans le silence glacé de la salle construite il y a huit cent cinquante-cinq ans par Rufus, fils de Guillaume le Conquérant. retentirent alors les quatre coups de Big Ben, l’horloge de Westminster. Les portes de chêne s’ouvrirent et le cercueil de George VI apparut, porté par des gardes en justaucorps gris.
Elizabeth menait le deuil. Elle se tenait très droite. Toute l’assistance avait les yeux fixés sur elle : ses parents comme les six cent vingt-cinq députés de la Chambre des Communes et les huit cent cinquante-six pairs de la Chambre des Lords. C’était, depuis la proclamation, sa première parution en public, ce fut sans doute la plus déchirante.
Quand elle se retira enfin, elle ne devait pas revenir devant ce cercueil avant les obsèques, quatre jours plus tard. Le roi appartenait à son peuple. Elizabeth, qui avait montré pendant près d’une semaine qu’elle avait la taille d’une reine, pouvait pleurer en silence au fond de ses palais ce père et ce roi, dont Churchill a dit que sa mort a réduit au silence le vacarme du XXe siècle ».
Pour toute question sur nos photos, anciens numéros et hors-séries, consultez nos services...








