Après avoir présenté son excellent spectacle, “Le Périmètre de Denver” au Centre Pompidou puis au 104, Vimala Pons part avec lui en tournée, et sort un livre-audio sur le label de Rebeka Warrior, WARRIORECORDS. L’occasion d’un grand entretien avec cette circassienne, actrice et metteuse en scène débordante de créativité.
On gardera très longtemps l’image de Vimala Pons grimée en Angela Merkel, portant une colonne de pierres sur sa tête, tout en retirant ses habits, couche après couche, dans une valse vestimentaire infinie, avant de finir nue sur scène. L’image exprimait la force et la faiblesse, le trop-plein de paroles et de couches, le mensonge et l’artifice, la vérité et le poids de la vie. L’humour, aussi. Son spectacle, Le Périmètre de Denver – expression inventée par ses soins désignant “un espace d’incertitude créé par un mensonge”– est une merveille d’écriture scénique, foisonnant et pourtant lisible, facétieux et singulier, déstabilisant et physique. Dans la foulée, l’actrice, circassienne et metteuse en scène sort un livre-audio sous forme d’EP sur le label de Rebeka Warrior (Mansfield. TYA, Sexy Sushi…), WARRIORECORDS, baptisé Eusapia Klane. Sa voix grave, “volontairement sensuelle”, dit-elle, narre une histoire surréaliste de vieille femme et de road-trip. On n’y comprend pas tout et c’est très bien ainsi.
Nous la retrouvons dans un café qu’elle fréquente assidûment compte tenu de la familiarité avec le patron, non loin des Buttes-Chaumont. Vimala Pons est une équilibriste en quête de déséquilibre pour mieux se rééquilibrer.
Dans ton spectacle, Le Périmètre de Denver, tu portes plein de choses sur votre tête – des pierres, une voiture… D’où vient cette quête d’équilibre ?
Vimala Pons- L’équilibre est une notion propre au cirque. J’utilise la notion d’équilibre afin de me poser des questions philosophiques. C’est pour cette raison que le cirque parle de 8 à 98 ans, car il soulève des questions philosophiques comme : “Pourquoi ça tombe ?”, “pourquoi je marche ?” Tirer les fils de ces questions simples mais fondamentales permet de se demander ce qu’est le déséquilibre dans sa propre vie. Mentir, c’est aussi rééquilibrer le réel dans ce qu’il a d’insatisfaisant. Les émotions sont des déséquilibres internes qui peuvent être très violents. Qu’est-ce que c’est qu’être déséquilibré mentalement ? Qu’est-ce qu’on porte et supporte dans la vie ? C’est quoi se tenir ? C’est quoi porter un amour, un discours ? Ma discipline s’est décalée vers l’idée de porteuse-équilibriste. On dit souvent aux filles : “je vais t’aider à le porter”, mais moi je trouve ça super de connaître le poids de ses désirs. Porter sa valise pour partir en vacances, c’est mesurer le poids de son désir d’aller en vacances justement.
Il y a un tableau de Basquiat qui m’a marquée. Ce sont deux bonhommes qui portent un canapé et au-dessus il a écrit “idéal”. Comme s’ils portaient leur idéal… qui serait un canapé ! Je ne sais pas très bien ce qu’il a voulu dire, mais ça m’a beaucoup parlé. C’est comme les névroses ou les obsessions. On ne sait pas toujours très bien pourquoi on veut plutôt taper sur une batterie ou souffler dans un saxophone. Quand tu y penses, tu vois que ça correspond souvent à ton inconscient et tu essaies de comprendre pourquoi tu es obsédé par ça. J’essaie de construire la narration là-dessus. Ces objets que les personnages portent dans le spectacle fonctionnent aussi comme des souvenirs, ou des pensées, comme les bulles dans les bandes dessinées. Quel poids font nos souvenirs ? Comment doit-on les déconstruire pour avancer ? Pardon, je parle à 300 000 à l’heure, non ? (Rires)
Comment et quand as-tu commencé à porter des choses sur ta tête ?
À 24 ans, à l’école du cirque avec une balle. Très vite, je me suis dit que le côté abstrait des agrès du cirque n’allait pas me servir à me projeter dans une fiction, n’était pas assez parlant. L’abstrait peut être parlant, bien sûr, mais je ne me voyais pas aller dans cette direction. Il n’y a pas assez de hors-champ. Les objets du quotidien sont alors arrivés très vite. Comme chez Maguy Marin, en danse, où l’accessoire est une grammaire. Il permet de raconter des choses.
Comment en arrive-t-on à porter une voiture de 28 kg sur sa tête ?
En yoga, quand on demande aux gens de se mettre sur la tête c’est un peu la même chose… Tu portes ton poids même si, c’est vrai, tu as tes mains appuyées au sol. On est très fort comme ça. Ce que je pratique n’est pas une spécialité de cirque, mais un moyen de transport. Tu as moins besoin de force quand tu es aligné. Il faut s’entraîner un peu, mais en Asie, en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui portent les choses de cette manière. Il y a aussi des hommes, par exemple sur les plateaux de la cordillère des Andes.
“Regarder ce qui change dans ce qui ne change pas m’a soignée parfois. Ça me fait du bien.”
Cherches-tu à te débarrasser du poids des souvenirs ou te nourrissent-ils ?
Les souvenirs nourrissent beaucoup. Même la pièce est truffée de choses un peu autobiographico-patinés – pour qu’on ne les reconnaisse pas en tant que souvenirs. Le ressassement et l’obsession sont très présents dans ma vie. Avec leur vertu qui est la création. Ils me permettent de me concentrer et d’épuiser une matière jusqu’à en tirer son essence. Ils permettent l’écriture. Le côté naze, c’est la rumination. La répétition n’est pas loin dans nos métiers. Tu entends quinze fois la même musique, tu vois 40 000 fois la même image en montage, tu redis 90 000 fois les mêmes mots. Regarder ce qui change dans ce qui ne change pas m’a soignée parfois. Ça me fait du bien.
Quelles sont ces obsessions ?
Là tu en as vu une majeure : j’ai besoin de porter des choses sur ma tête. J’ai besoin d’être dans une sensation d’équilibre ou de déséquilibre. C’est de la méditation active. Ça calme mon éparpillement mental. Tu reviens à une chose essentielle : tenir en équilibre quelque chose. Ça place ta respiration au bon endroit. J’aime le défi. C’est un moteur, une drogue très forte. Je n’ai pas la maturité de me satisfaire des choses ténues, simples. Je suis plutôt dans la surenchère du défi. Quand j’ai découvert Anne Clark il y a quelques mois, ainsi que le dernier album de Kate Bush, 50 Words for Snow, je les ai passés en boucle du matin au soir. J’aime épuiser les choses. Je peux manger 400 fois le même plat, revenir tout le temps dans le même café. Mais mentalement, je m’éparpille. Il faut savoir où placer le cadre pour te tenir droite.
Comment tu te cadres ?
J’ai décidé que j’avais envie de tout, tout le temps, avec tout le monde, maintenant, pour toujours. (Rires) Le mauvais éparpillement a été de ne pas l’accepter. Le jour où j’ai accepté de tout vouloir, tout le temps avec tout le monde, ça m’a fait du bien. J’ai travaillé à ce que ce soit possible et transmissible aux autres. Dans Le Périmètre de Denver par exemple, j’ai voulu écrire une histoire policière car il y a quelque chose de pop là-dedans, dans le fait de raconter des histoires, de construire des fictions assumées, alors que les contours de la réalité sont hyper flous à l’heure actuelle… Les catharsis assumées font du bien, les vraies histoires fictionnelles ! Je suis fan de Colombo. J’ai regardé deux fois l’intégralité de la série. Je voulais aussi une grande physicalité, je voulais que la musique soit interpénétrée avec la façon de dire le texte. Je voulais aussi qu’il y ait un mode sculptural, et du mouvement qui ne soit pas de la danse. Je me suis dit “je vais faire tout ça !”, je voulais aussi un truc poétique, où des gens racontent des trucs de vie, comme chez un psy. J’adore quand, dans certains films, une phrase te percute en plein cœur et te porte pendant des semaines. J’ai pris du temps pour tout écrire par couches et ensuite ajuster. Parfois ça s’est mal passé. À un moment j’ai compris que je n’aurais pas l’histoire policière comme au cinéma où tu dis tout en quelques plans. Au théâtre, c’est un texte comme ça (elle mime un texte long) avec des descriptions et des didascalies. Au cinéma, en cinq secondes, tout le monde a compris qu’il avait mis le poison dans le verre. Donc je me suis dit que j’allais faire quelque chose d’ouvert, avec une trame, mais que chacun comprendra comme il ou elle le souhaitera et sortira avec son Cluedo. C’est plus psychédélique qu’une histoire cartésienne. Dans Rashōmon de Kurosawa, chacun a sa version. On ne sait pas bien ce qui est vrai ou faux.
Tu as également l’air obsédé par le mensonge, qui est au cœur de ton spectacle.
Créer des histoires fait de nous des êtres d’humains. Nous nous rassemblons sur des mythes et des symboles. C’est précieux et ça a à voir avec le fait de mentir et à la fois pas du tout grâce au pacte fictionnel. L’histoire commence par “il était une fois”. On peut donc s’y projeter sans crainte. Alors que dans le mensonge, le pacte est flou. Moi, je pratiquais le mensonge pour rééquilibrer des endroits de moi-même qui ne me satisfaisaient pas, comme le fait d’être en retard. Quand on séduit quelqu’un, au départ on lui présente toujours la meilleure version de nous-même, puis ça s’effondre ! C’est de la démagogie cognitive, ou de séduction. Tu donnes à la personne ce qu’elle attend de toi. Je me suis dit que c’était quand même politique. En amour, en amitié, en famille, en politique, quand quelqu’un te dit quelque chose de faux, c’est très compliqué… Car la parole a un pouvoir performatif.
Pourquoi sortir ce livre-audio, Eusapia Klane, qui entre dans l’univers du spectacle en suivant l’un de ses personnages, mais possède sa vie propre ?
Pour Le Périmètre de Denver, j’ai commencé par construire les objets. C’était la première couche. Je veux porter ci et ça, tel déséquilibre, telle chose, varier les matières, les formes. Puis il y a eu le confinement. Tout a été arrêté. La poussière est tombée dessus. Je suis partie avec un sac. J’ai écrit cet EP qui parle de cette femme qui adore sa voiture mais qui n’ira jamais nulle part avec. Je ne voyais pas la connexion avec le spectacle au départ. Cette histoire est inspirée par Crash que je venais de découvrir, mais aussi Anne Clark, Laurie Anderson et les 120 000 films de Carpenter que je revisionnais. J’étais confinée avec Rebeka Warrior à qui j’empruntais le micro. J’ai aussi acheté un petit clavier Akai sur Internet, et j’ai écrit pour le spectacle mais loin de la réalité du plateau. Quand je suis revenue en résidence, j’ai reçu la première prothèse de visage, j’ai appuyé sur play sur le premier track de cet EP et j’ai fait du play-back. J’ai trouvé ça super de porter ce visage de vieille femme réalisé en prothèse, et de le coupler à cette voix que j’avais voulu hyper sensuelle. J’ai trouvé que faire rentrer des voix qui ne correspondent pas aux corps fonctionnait. Rebeka Warrior m’a invitée à le sortir sur son label WARRIORECORDS. Je ne le sentais pas au départ, mais je l’ai fait.
“Je me déplace mais je sais où est ma place”
Tu es donc, aussi, musicienne ?
C’est bien de ne pas quitter son art originel. Ça ne m’empêche pas de faire du son, de chanter, ou de coudre. Mais je tiens à ma formation qui est le jeu et le sport, le cirque. Tu peux habiter d’autres sphères, mais je maîtrise le cirque, pas la musique, où j’entretiens exprès un niveau un peu naze. Ça me permet de faire des choses intéressantes car c’est maladroit. Je le sais car les musiciens professionnels sont parfois touchés par ce que je fais mais parce que ça reste à cet endroit-là. Si je voulais progresser, ça mettrait dix ans à être convaincant. Quand la pluridisciplinarité est arrivée dans les années 1970-1980, elle a envoyé valser la technique, elle voulait casser ce truc classique qui exigeait de la technique dans l’expression artistique. Or, je fais un retour là-dessus : je me déplace mais je sais où est ma place.
Comment as-tu commencé ?
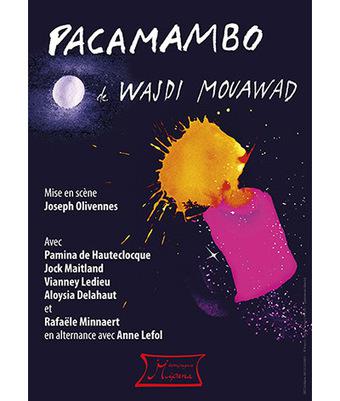
Vers 18-19 ans j’ai fait histoire de l’art à la Sorbonne. Je n’ai pas du tout aimé donc je suis partie en fac de cinéma à Saint-Denis. Je voulais être scénariste, présenter la Fémis. J’ai écrit un court métrage à 18 ans. J’ai intégré le cours Florent pour rencontrer des acteurs. Ce que j’ai fait. Je n’ai jamais dérushé ni monté ce court métrage, ce qui est hallucinant. Il faut que je le fasse. Je me suis fait prendre au jeu. L’aspect théorique, je trouvais ça super, mais j’ai beaucoup aimé jouer. Mes parents n’y croyaient pas trop… Enfin, personne n’a envie que sa fille soit actrice. Ma mère voulait que je sois conférencière et mon père genre tenniswoman. Je ne voulais pas qu’il le finance donc je suis allée au conservatoire, puis à l’école de cirque. Je ne connaissais rien au théâtre. C’était un coup de bol.
Tu venais d’un milieu créatif ?
Non. Ma mère était décoratrice d’intérieur, et mon père vendeur de programmes informatiques.
Sais-tu toujours ce que tu veux ?
Oui. J’adore tout écrire avant et ensuite qu’on teste. C’est agréable pour tes collaborateur·trices quand tu sais ce que tu veux, tout en restant ouverte à la proposition. Il vaut mieux dire “ça c’est rouge” et puis ensuite “en fait c’est bleu !” Que de dire“je ne sais pas.. t’en penses quoi ?” Car au fond, ce n’est pas très grave et c’est plus vivant.
C’est la confiance qui te permet de concrétiser une proposition ? Tu doutes parfois ?
Pas beaucoup. Quand je doute c’est un gouffre horrible et le seul moyen de s’en sortir, c’est le complexe de supériorité (rires) Et la répétition. Le doute ne construit pas toujours des choses bien, ça ne marche pas avec moi. Je préfère tirer dans tous les sens comme dans un western et dire “nul, nul, nul, ça ok !” et avancer ainsi. Je dis beaucoup “j’essaie” puis “c’est de la merde”. Mais c’est pas grave, je mets à la poubelle et j’essaie autre chose.
Comment as-tu rencontré Rebeka Warrior ?
Par sa petite amie, Pauline, qui nous a quitté·es et à qui l’album est dédié. On met toutes les deux vachement de temps en amitié. On a mis longtemps à accorder notre confiance… Maintenant c’est indéfectible. C’est quelqu’un d’extraordinaire, je l’adore.
Tes ami·es te permettent d’avancer aussi ?
Je trouve que c’est assez solitaire comme travail. J’ai pensé à l’inviter à des filages, mais je ne l’ai jamais fait. En revanche, le fait d’aller boire des cafés et de partager la difficulté de création, la remise en question, le doute, la baisse de confiance, la méthode de travail… Savoir comment se surprendre soi-même pour tirer le meilleur de soi-même. On échangeait pas mal. Ça aide plus que de confier des anecdotes. Ça a été un vrai soutien.
C’est la même chose avec Bertrand Mandico, réalisateur avec qui tu as tourné à plusieurs reprises, notamment dans Les Garçons sauvages (2017), et After Blue (2022) ?
On est plus sur des échanges de sources, de films, de références. Ou bien, on se redonne du courage en se disant que c’est important de persévérer quand on perd la foi. Quand tu la perds c’est très compliqué… Il n’y a que toi qui peux la retrouver, mais parfois prendre un café ou un verre avec un·e artiste qui a partagé les mêmes affres que toi est essentiel. Il suffit d’une phrase et tu repars plein d’énergie. J’ai rencontré ses films d’abord, avec Tsirihaka Harrivel, à la Villa Médicis, où nous avions notre première résidence d’écriture. Une pensionnaire de la villa, Elina Löwensohn (compagne de Bertrand Mandico, ndlr) présentait tous ses courts métrages. J’étais morte de rire. Je trouvais l’humour très particulier. Après, on a discuté. Elle nous a raconté que quand Bertrand Mandico l’a rencontrée, il lui a proposé de réaliser 21 films en 21 ans, pour la séduire. Ils le font ! Ils font un court par an. J’ai toujours été touchée par les couples créatifs, qu’ils soient frères, ami·es, amant·es, etc. Et j’aime la réalisation très visible, le fait d’assumer ce décollement de la réalité, ce poème visuel, très référencé. C’est important parce qu’il travaille comme un artisan. Il est cadreur de ses films. C’est rare de travailler de cette manière. Ce n’est pas que par fétichisme d’un ancien temps, ça m’a inspiré de tout faire en post-synchronisation, de dissocier les dialogues de l’image. Les Américains le font beaucoup, même à l’heure actuelle.
À quoi cela sert-il ?
Tu as une deuxième chance au jeu. Tu peux dissocier l’intensité de jeu que tu as à l’image de celle que tu as vocalement. Techniquement, j’ai trouvé ça passionnant. Il y a une proximité avec la voix qui est très intéressante et qui nous décolle un peu de cet héritage Nouvelle Vague dont on a largement soupé je trouve. Il y a un fétichisme d’un ancien temps, c’est sûr… Mais qui je pense est un amour du cinéma, une cinéphilie qui me touche beaucoup. C’est un bosseur incroyable Bertrand. Ses storyboards ressemblent à des bouquins d’aquarelles. C’est un vrai fabricateur de films. Il sait faire des films. J’adore la technique, que ce soit savoir pleurer, ou faire une surimposition d’images. C’est beau de connaître les outils de ton art. Ça me touche. Je ne sais pas bien pourquoi.
Peut-être parce qu’il y a une vérité là-dedans ? Quelque chose de tangible dans la technique, dans la maîtrise d’un art…
Peut-être oui. J’ai du mal à savoir. C’est comme ça.
Quel est ton rapport quotidien à la musique ?
J’en écoute beaucoup. Le matin, depuis 7-8 ans, je mets de l’ambient japonaise qui me permet de ne pas me suicider. (rires) Beaucoup de musique classique aussi. J’ai découvert, il y a quelques années, qu’on pouvait découvrir de la musique (rires). C’est une nouvelle phase ! Je me suis mise à chercher sur Internet. Avant, j’écoutais ce qui me parvenait, ce que je connaissais. Là, d’un coup, je suis allée au-devant de ce que je ne connaissais pas. Je n’aime pas trop les vinyles, plutôt les CD. J’aime aussi écouter la radio. J’écoute des radios américaines, italiennes, argentines… Je mets aussi beaucoup de DVD que je branche sur la chaîne hi-fi, sans l’image. Je les écoute sans les regarder. Parfois, je connais donc mieux les films par le son. Quand je les revois, je décolle… J’avais imaginé un autre film ! Le dernier c’était La Vie aquatique de Wes Anderson. Je n’avais pas revu le film depuis cinq ans, mais je connaissais le son par cœur. Je pouvais faire le mouvement de porte avant que le personnage n’arrive…
Et Kate Bush aussi donc, dont tu parlais plus tôt ?
C’est son Fifty Words for Snow. C’est je crois son dernier album. Piano-voix, assez jazzy. J’étais assez déçue au début. On aurait dit un concert dans un hall d’hôtel Ibis Style. Comme elle est trop forte… retour aux instruments ! Piano à queue, violons, voix… Elle fait un morceau hyper long niveau format, avec sa voix super aiguë, très fragile, sa voix qui a vieilli. Elle écrit tellement bien. Il me porte depuis le mois de janvier. J’adore quand à la première écoute tu te dis “c’est nul”, et en fait tu adores par la suite.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de le réécouter ?
Trois-quatre accords qui m’ont donné une émotion. Et ses virages ! (elle imite sa façon de chanter dans les aigus)
Pour finir, il y a chez toi un certain jeu sur les stéréotypes de genre, que l’on retrouve dans ton spectacle. Comment as-tu pris conscience de la construction du masculin/féminin ?
Quand j’étais petite, j’ai eu mes règles tardivement. J’avais de la super-androgynie, donc j’ai eu un traitement hormonal pendant deux ans afin notamment de garantir que je puisse avoir des enfants… Avant ça, j’étais un garçon manqué. Je ne voulais pas du tout être une fille féminine. On m’appelait jeune homme. J’avais les cheveux courts, je m’habillais comme un garçon. Après le traitement, je suis devenue féminine dans un code genré : épilation des sourcils, cheveux qui poussent, attitudes de séduction, rapprochement des garçons. Je n’avais aucune conscience féministe. Si ma conscience féministe est advenue, c’est par le corps. Par une envie de ne pas être aidée, d’être aussi forte qu’eux, qu’on ne se pose plus la question de mon genre. J’ai vu des circassiennes faire des choses dont on ne les soupçonnait pas. C’est grâce aux rencontres que j’ai faites par la suite que j’ai pu mettre des mots sur ce combat qui a toujours été là de manière inconsciente, mais pas du tout intellectualisé. La représentation de la femme au cinéma par exemple… On avait une scène courte dans un film où on devait passer par-dessus une barrière. Le réalisateur me dit:“je vais passer d’abord, ensuite je te tends la main”. J’ai refusé. Je pouvais passer la barrière mieux que lui. Il justifiait tout ça avec l’intrigue. Chez moi c’est du féminisme intuitif. Ça m’agaçait. Je n’aimais pas ce que ça disait du personnage, ni de moi. Je me suis beaucoup battue pour beaucoup de détails comme ça. Comme la façon de boire une tasse de café. Je la tenais des deux mains. On me dit que ce n’est pas comme ça qu’on boit. Des discussions entières ont suivi…On me montrait comment “une fille” boit en tenant la tasse par l’anse, avec la main bien mise. Au cinéma, on se retranche beaucoup derrière la notion de personnage, donc on peut tout te faire gober. Mais en tant qu’actrices et acteurs on est très responsables des codes que lon fait passer.
Propos recueillis par Carole Boinet
Le Périmètre de Denver, les 22, 23, 24 mars à Nantes (Le Lieu Unique), les 30, 31 mars à Bruxelles (Halles de Schaerbeek), le 8 avril à Val-de-Reuil, Festival SPRING (Théâtre de l’Arsenal), les 13, 14 avril à Annecy (Bonlieu), les 5, 6 mai à La Rochelle (La Coursive) et les 17, 18, 20, 21 mai à Grenoble (MC2)
Eusapia Klane (WARRIORECORDS/Kythibong)








